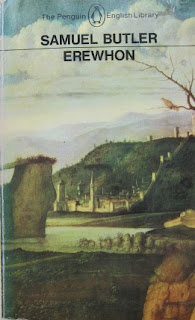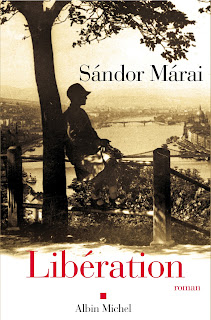mardi 26 septembre 2017
Journal d'un raté - Edouard Limonov
Ce prétendu journal est composé d'une série de fragments, chacun faisant quelques lignes, ou quelques pages. Si certains sont très cryptiques, il en ressort une peinture de la vie de Limonov à New York, écrivain sans succès, pauvre, marginal, amateur de femmes, et d'hommes aussi, à l'occasion. Il lui arrive d'avoir d'étranges pulsions de violence, de fantasmer sur une révolution sans cause précise, et de prendre une pose de rebelle adolescent.
J'ai lu ce bouquin en trois phases. D'abord, c'est vaguement déplaisant. Limonov n'est guère sympathique, le ton alambiqué qu'il emploie fait un peu prétentieux, le choix de faire du cryptique aussi. Je me dis que je préfère les ratés de Dostoïevski. Puis, au bout de quelques dizaines de pages, je me laisse emporter par sa prose. Limonov à une plume, une très belle plume. L'écriture saccadée, pleine de haine et de désespoir, d'un mélange de puissante pulsion vitale et de nihilisme, est accrocheuse. Ces petits morceaux de vie glauques s'enchainent rapidement, comme une bonne rythmique. Ce Journal d'un raté est un bon poème en prose. Et, pour finir, je me sens écœuré. Ce bouquin ressemble à une liste des aventures du pénis de l'auteur jumelée à une liste de ses haines. C'est lassant. C'est chiant. Une glorification narcissique de son mode de vie volontairement chaotique.
Un peu dommage que quelqu'un avec une telle vie et une telle plume choisisse de parler essentiellement de sa bite.
279 pages, 1982, albin michel
vendredi 22 septembre 2017
Syzygy (Le crépuscule des mondes 2) - Michael G. Coney
Il est frappant de constater à quel point Syzygy (1973) est quasiment le même roman que Rax (1975). Voyons les points communs. Dans une petite ville côtière, sur une distante planète colonisée par les humains, la vie suit tranquillement son cours. Mais cette banalité est rapidement perturbée par un événement mystérieux spécifique à cette planète, un événement d'échelle considérable qui fait comprendre aux humains qu'ils ne connaissent pas grand chose de leur environnement. Et qu'ils sont bien fragiles. Puis le ton devient progressivement plus sombre, la société se disloque et les hommes se retournent les uns contre les autres.
Dans Syzygy, l’événement est question, c'est la grande marée liée à la conjonction des 6 lunes de la planète, marée arrivant tout les 50 ans environ. La dernière fois, les villages côtiers ont été le théâtre de violences inexplicables. Cette fois, les villages sont devenues des villes, et des psychologues sont sur place pour enquêter. Les océans de la planète recèlent bien des secrets, et le plancton, pendant les grandes marrées, se retrouve doté de quelques propriétés intéressantes. Petit à petit, les humains se retrouvent à percevoir les pensées d’autrui, à ressentir leurs émotions, à mêler leurs esprits l'un à l'autre. Et, bien entendu, la plupart des gens ne sont pas assez futés pour gérer la situation. Un petit groupe de personnalités plus tranchées se retrouve à essayer de s'en sortir dans un village qui perd la tête, chacun se laissant emporter par les torrents de haine et de pulsions diverses. L'action télépathique du plancton n'est qu'un prétexte : ce qui est le sujet, c'est l'instinct grégaire de l'humanité, la tendance à suivre aveuglément les mouvements de groupe, à chercher des bouc-émissaires plutôt que d'agir rationnellement. Ceci aussi bien à l'échelle d'un village, qui se livre à une chasse aux sorcière, que d'un gouvernement, qui choisit à des fins électorales de régler de problème par la force brute, en intoxiquant les océans plutôt qu'en évacuant. Le thème est classique, mais habilement mis en scène. Et, comme dans Rax, la solution vient d'une nature qui est naturellement équilibrée. Le problème vient de l'homme, qui croit pouvoir s'exclure de cet équilibre.
Ce n'est pas parfait pour autant. L'intrigue intimiste, du narrateur ayant perdu sa fiancé et flirtant avec la sœur de celle-ci, n'est guère transcendante. Et heureusement que les femmes sont là pour faire le ménage, car « Tu sais ce que devient une maison quand un homme vit seul. » Mouais. Si je me permet de mentionner ce détail, c'est qu'il revient revient quand même plusieurs fois, ce qui est en soi un exploit. Et si Rax m'avaient gentiment ennuyé au début et se rattrapait avec une fin excellente, là, c'est beaucoup plus stable : plutôt pas mal du début à la fin. La SF est une littérature qui voit loin et large, et il est plaisant de tomber sur ce genre de variante à petite échelle : on se sort jamais d'un village d'environ 500 habitants. De la SF qui voit loin en restant d'une sobriété peu fréquente.
1973, Bragelonne
Libellés :
Coney Michael G.,
Littérature,
Science fiction
mercredi 20 septembre 2017
Rax (Le crépuscule des mondes 1) - Michael G. Coney
Sur une lointaine colonie humaine, la guerre gronde, à l'horizon. Le jeune Pastour ne s'en soucie guère. Ses parents l’emmènent en vacance sur une petite ville côtière, comme chaque année, et il va retrouver la fille qui titille ses hormones toutes fraiches. Mais la guerre se rapproche, et la vie quotidienne se transforme lentement mais inévitablement.
L'écriture de Michael Coney est d'un classicisme parfois frustrant, mais efficace. Par contre il y a une maladresse qui brise l'immersion. Ce monde lointain étant redouté pour le froid mortel de ses nuits, ses habitants utilisent le verbe congeler et ses diverses variantes comme un juron. L'auteur, très fier de sa trouvaille, la place toutes les dix lignes, ou presque. C'est comme si les personnages parlaient en disant en permanence putain ou salaud. On s'en lasse vite. Sinon, on se laisse aisément prendre dans ce qui est en bonne partie une "simple" histoire d'adolescence. Le narrateur s'engueule avec des parents qui ne le comprennent pas, il se cherche une place parmi ses pairs et dans la société en général, il apprend les mystères de l'amour avec la jeune... Prunelles-d'or. Vraiment ? Pourquoi pas Joli-cœur, ou Rose-printanière ? La principale caractéristique des jeunes filles semble d’ailleurs être qu'elles veulent que le narrateur leur dise qu'elles sont jolies. Ce n'est pas toujours très subtil, notamment quand le narrateur dit des choses comme « Oh la la, je prends conscience de moi-même en tant qu'individu, mais comment trouver ma place dans ce monde ? » Et je n'exagère quasiment pas.
Bref, j'ai eu envie de stopper ma lecture à mi-chemin, mais je me suis laissé emporter par le rythme et l'univers. Et j'ai bien fait, vraiment. Vers la fin, tout change. Brutale rentrée dans le monde adulte. Le ton devient terriblement sombre, et tout ce qui avait été construit dans la majeure partie du roman est balayé, ou presque. Pour Pastour, c'est la perte totale de foi dans le monde des grands, dans la société hiérarchique. Puis, dans les dernières lignes, une touche d'espoir est délicatement ramenée. Le salut ne vient pas de l'homme et de ses institutions, mais de ce qui n'est pas humain.
1975, Bragelonne
Libellés :
Coney Michael G.,
Littérature,
Science fiction
lundi 18 septembre 2017
Erewhon - Samuel Butler
Un roman plus ou moins utopique qui prend la forme d'une satire de la société victorienne. Parlons tout de suite des problèmes. Comme souvent dans ce genre de littérature, c'est hautement descriptif. Butler passe la plupart de son temps à décrire en détail les habitudes et croyances des Erewhonien. Pour ce qui est d'une narration classique, c'est le strict minimum. Le narrateur arrive en Nouvelle-Zélande, part à l'aventure derrière des montagnes inconnues, tombe sur Erewhon, se dépatouille en tant qu'invité/prisonnier, se trouve une copine et s'enfuit. Ensuite, le roman accuse un peu son age. C'est aride, très aride, d'autant plus qu'on est loin de l’Angleterre victorienne : j'ai souvent eu l'impression de ne pas pouvoir tout comprendre faute d’être suffisamment familier avec la société contemporaine de Butler. Du coup, j'avoue avoir sauté beaucoup de pages. C'est le genre de livre que j'aurais sans doute dû lire en français : j'aurais pu aller beaucoup plus vite et peut-être m'ennuyer moins. Ou peut-être pas.
Butler ne manque cependant pas d'idées, ni d'humour. Les Erewhoniens traitent le crime comme la maladie, et la maladie comme le crime. Un homme atteint de grippe sera jugé et condamné, alors qu'un homme volant de fortes sommes se verra entouré de la compassion de ses proches et pris en charge par un praticien chargé de guérir les mauvaises tendances de son esprit. Une inversion totale par rapport à la société de Butler, inversion qui met en avant les failles des deux systèmes. Le narrateur est outré quand il entent le juge dire au grippé condamné quelque chose comme : « Tu n'avais qu'à naitre de parents plus sains ! », mais il oublie que les criminels victoriens sont, eux aussi, souvent punis pour être mal nés. Le narrateur juge les Erewhoniens trop modelés par leur société défaillante de voir ce qu'il considère comme la vérité, oubliant que sa vérité n'est pas moins arbitraire. Il constate qu'à Erewhon comme chez lui l'hypocrisie est partout présente, des systèmes de croyances différents voire opposés pouvant cohabiter sans souci. Hypocrisie particulièrement présente dans le monde religieux :
Their priests try to make us believe that they know more about the unseen than those whose eyes are still blinded by the seen, can ever know - forgetting that while to deny the existence of a unseen kingdom is bad, to pretend that we know more about it than its bare existence is no better.Les prêtres d'Erewhon ne manquent pas non plus de préceptes d'une rare profondeur spirituelle :
Thus they hold it strictly forbidden for a man to go without common air in his lungs for more than a very few minutes; and if by any chance he gets into the water, the air-god is very angry, and will not suffer it; no matter whether the man got into the water by accident or on purpose, whether through the attempt to save a child or through presumptuous contempt of the air-god, the air-god will kill him, unless he keeps his head high enough out of the water, and thus gives the air-god his due.Si les prêtres d'Erewhon n'ont rien à envier aux prêtres anglais, les professeurs d'université non plus :
“It is not our business,” he said, “to help students to think for themselves. Surely this is the very last thing which one who wishes them well should encourage them to do. Our duty is to ensure that they shall think as we do, or at any rate, as we hold it expedient to say we do.”Les traits d'esprit de Butler parviennent donc à donner envie de se frayer une chemin dans l'aridité de son récit. Et il faut mentionner un élément particulièrement précurseur : le rapport à la technique. Les Erewhoniens ont banni toutes les machines de leur société par crainte que celles-ci ne se développent de façon trop envahissante. Ils craignent que les machines ne supplantent rapidement la race humaine. Butler parvient à cette conclusion en appliquant le darwinisme aux machines. Celles-ci connaissent une évolution d'une vitesse tellement fulgurante qu'elles laisseront loin derrière elles les créatures de chair. En prenant l'exemple d'un homme conduisant une voiture, Butler envisage l'avenir avec une clairvoyance frappante. Il conclut que, logiquement, la machine qu'est la voiture se verra pourvue des sens de l’homme : la vue, pour savoir où aller, et la voix, pour communiquer avec les autres véhicules. Ce qu'envisage Butler, c'est tout simplement les véhicules autonomes, qui perçoivent les routes et le trafic par leurs propres « sens ». Pas mal comme anticipation, pas mal.
260 pages, 1872, penguin books
jeudi 14 septembre 2017
Les chants de la Terre lointaine - Arthur C. Clarke
Un matin comme un autre, l'humanité découvre que le soleil est décidé à se transformer en nova plus rapidement que prévu, dans un peu plus d'un millénaire. Du coup, beaucoup d’efforts sont faits pour répandre l'espèce dans les étoiles. Quelques vaisseaux ensemenceurs sont envoyés sur des planètes potentiellement habitables. Ils contiennent des embryons congelés qui devront être élevés par des systèmes automatiques, ou juste du matériel ADN pour créer des humains à partir de matières premières. Sur Thalassa, la planète représentée en couverture, l'expérience a été un succès. La Terre est consumée, mais environ sept siècles après l’arrivée de leur arche, les thalassans vivent dans un petit paradis. Sur la planète-océan, il n'y que peu de terres, donc peu de population, donc peu de problèmes. Et voilà que tout d'un coup débarque un visiteur inattendu. Juste avant que la Terre ne soit dévorée par son étoile, les derniers terriens ont découvert la technologie permettant des vols habités. Un vaisseau a pu être terminé à la dernière minute, et le voilà qui arrive, venant chercher sur Thalassa de la glace pour son bouclier à particules, avant de reprendre sa route.
Et il ne se passe pas grand chose d'autre. Si Clarke a généralement un ton calme et paisible, là, c'est vraiment extrême. Sur Thalassa, tout va bien. Pas de guerre, pas de religion, pas de dangers, et de l'amour libre à profusion. Mais comment faire un roman sans tension ? Clarke inclut bien quelques petits rebondissements. Par exemple, quelques ex-terriens veulent tellement rester sur Thalassa qu'ils envisagent de saboter leur vaisseau. Du quoi créer du conflit, de la violence ? Non. Les coupables sont démasqués, et leur châtiment est de... rester sur Thalassa. Là, l'optimisme maladif de Clake va un peu loin. Un capitaine de vaisseau, qui a la responsabilité d'un million de vies (la majorité en cryostase), récompenser ainsi la mutinerie ? Peu crédible. Dans le même genre, Clarke relègue comme c'est son habitude la religion dans les poubelles du passé, et part du principe que toute société un minimum scientifique devient naturellement rationnelle. Ainsi les terriens sont athées, et les thalassans ont oublié jusqu'au concept de divinité. C'est l'occasion d'au moins une jolie phrase : « Moïse Kaldor avait toujours adoré la montagne ; il s'y sentait plus près de Dieu, dont il regrettait encore parfois la non-existence. » Clarke soulève la question intéressante de l'héritage à laisser aux colonies. Si Thalassa est un petit paradis, ce serait, selon Clarke, parce que leur culture a été soigneusement préparée et censurée. Ainsi, aucune œuvre de fiction qui leur mettrait dans la tête des idées comme la religion ou la guerre. Pas de Dostoïevski pour eux, pas de Milton, pas de Saint Augustin. C'est un peu simpliste, mais une autre interprétation, que je préfère, est possible. Enterrer une société sous l'infinité des créations du passé, c'est l'étouffer. Mieux vaut peut-être lui fournir simplement quelques bases, et lui laisser de l'espace pour respirer et s’épanouir.
Sinon, entre deux flashbacks concernant la Terre, les divers personnages se baladent, se font des câlins, s’interrogent sur leur place dans l'univers, traversent des chagrins d'amour et examinent de grosses langoustes intelligentes. Vraiment, c'est paisible, d'une tranquillité un peu soporifique. Après tout, Thalassa est une utopie. Et si Les chants de la Terre lointaine se laisse lire grâce à l'écriture limpide de Clake et à quelques bonnes idées, on n'a jamais l’impression de dépasser le statut de petit roman sympathique.
343 pages, 1986, milady
Libellés :
Clarke Arthur C.,
Littérature,
Science fiction
mardi 12 septembre 2017
La cité et les astres - Arthur C. Clarke
Dans pas moins d'un milliard d'années, les derniers humains vivent dans une unique cité technologiste. Une utopie qui leur accorde la satisfaction instantanée de tous leurs besoins physiques, mais une utopie figée. Les enfants ne naissent plus, toute possibilité de changement a disparu, et il est impossible à quiconque de quitter la cité mère qu'est Diaspar. Les humains vivent des milliers d'années, puis replongent dans le grand tout de l'éternité électronique pour quelques dizaines de millénaires, et renaissent ensuite au monde en récupérant la mémoire de leurs vies passées. Mais voilà qu'apparait un jour Alvin, un être neuf, original, qui vit sa première incarnation. Contrairement à ses compatriotes, il ressent l'appel de l'inconnu et se lance dans une quête initiatique à la structure tout ce qu'il y a de plus classique. Appel de l'aventure, aide du mentor, découverte d'un nouveau monde, rencontre avec la mort, appropriation d'un objet aux propriétés curatives, chemin du retour et changement appliqué au monde du début.
Cette structure d'une efficacité éternelle fonctionne toujours aussi bien quand elle est utilisée par un auteur de talent. Le principal problème du roman, c'est ce que découvre Alvin en dehors de Diaspar : une communauté d'humains télépathes, à la fois technologistes et vivant en harmonie avec la nature. Dans la ville qu'est Diaspar, la stagnation de l'humanité sur une échelle de temps colossale (un milliard d'années) fait sens : la cité a été créé dans ce but, et une science d'une invraisemblable puissance s'emploie à maintenir le statu quo. Mais les gens vivant hors de Diaspar n'ont pas de telles barrières. Comment, au fil des millions d'années, n'ont-ils pas eu envie de reconquérir le désert qui recouvre la Terre ? D'aller toujours plus loin, explorer derrières les montagnes, puis derrière les étoiles ? C'est une faille logique assez problématique.
Mais à part ça, La cité et les astres reste de l'excellente SF qui voit loin et large. On ressent à accompagner Alvin le véritable souffle de la découverte. Son objectif est tout simplement de découvrir autrui, de découvrir d'autres formes d'intelligence, humaines ou non. Et son voyage l'amène à explorer un univers où l'homme n'est que peu de choses. Un univers qui autrefois débordait de vie, mais qui n'est plus que l'ombre de lui-même. On pense inévitablement à la Culture de Iain Banks, sur qui Clarke a dû avoir beaucoup d'influence, pour deux raisons. Cette vision d'un futur envisageant l'économie de l'abondance, un futur où la matière est maitrisée, et l'homme n'a plus guère à lutter pour vivre. Mais aussi cette idée d'une inévitable évolution vers d'autres formes de vie supérieures, intangibles, évolution appelée chez Banks Sublimation. Clarke est encore une fois d'un optimisme presque naïf. Il n'y a jamais vraiment de danger, de tension, sinon celle de la soif de connaissance. Quand un personnage s'exclame « nous sommes en temps de crise », on sourit, tant cette crise est légère et inoffensive. On sourit aussi quand Clarke parle d'amour, tant le sujet, littérairement du moins, n'est pas son point fort. Mais dans l'ensemble, cette SF paisible et optimiste, se reposant sur la curiosité envers l'immensité du temps et de l'espace, est un plaisir délicat.
348 pages, 1956, Folio SF
Libellés :
Clarke Arthur C.,
Littérature,
Science fiction
samedi 9 septembre 2017
The fountains of paradise - Arthur C. Clarke
Sous ce titre poétique se cache un type de SF bien particulier : le fantasme d'ingénieur. Gigantesques machines, vaisseaux colossaux, ce genre de choses. Ici, l'artéfact en question, c'est un ascenseur spatial de quelques dizaines de milliers de kilomètres de hauteur. Ou de longueur, selon comment on voit la chose. Si aujourd'hui le concept est relativement médiatisé, il était à l'époque d'écriture du roman plus obscur, je crois. Clarke place ce projet dans un Sri Lanka semi-fictionnel : il prend ce qui lui plait de la réalité tout en modifiant les choses pour rendre son récit crédible. Alors, comment parvient-il à intéresser (ou non) le lecteur à son prodige d'ingénierie ?
Clarke prend son temps, ce qui est à la fois plaisant et troublant. Il consacre ainsi plusieurs chapitres à un ancien roi local, habitant non loin de la montagne sacrée qui deviendra la base (ou le sommet, encore un fois, question de point de vue) de l'ascenseur spatial. Pourquoi pas, c'est plutôt bien écrit, mais le rapport avec l'intrigue principale est ténu. On a surtout l'impression que Clarke aime beaucoup le Sri Lanka (il y a vécu) et que du coup il a envie de se faire plaisir en faisant un peu de fiction historique. Il consacre aussi quelques chapitres à un thème bien plus classique : le premier contact. Ces parties sont très réussies. L'humanité est simplement contactée par une sonde exploratrice, qui passe tranquillement de système solaire en système solaire pour envoyer à ses créateurs toutes les infos sur les formes de vie qu'elle y découvre. Les extraits de ses discussions avec l'humanité sont peut-être les meilleurs passages du roman. La sonde s'emploie tranquillement à démolir les superstitions humaines avec une adorable et absolue rationalité. Clake, un peu naïvement, sous-entent que la bonne parole de la sonde suffit à détourner la majorité de l'humanité des religions. Voici le message d'adieu de la sonde :
Starholme informed me 456 years ago that the origin of the universe has been discovered but that I do not have the appropriate circuits to comprehend it. You must communicate direct for further information. I am now switching to cruise mode and must break contact. Goodbye.Mais encore une fois ce n'est qu'une sous-intrigue, qui n'a d'impact que dans l'épilogue, qui d'ailleurs suggère beaucoup de choses qui donnent envie d'en savoir plus.
Mais la majorité du roman, c'est la construction de l’ascenseur spatial. La première partie est la plus intéressante : il s'agit pour Morgan, l'ingénieur qui porte le projet, de convaincre le monde de son importance. Préparer les esprits est nettement plus intéressant que préparer la construction elle-même. Des moines bouddhistes habitent au sommet de la montagne sacrée qui, pas de bol, est l'unique site possible. Cet aspect du récit est très bien amené : la tension entre une spiritualité traditionnelle hors du temps et la pression d'un projet potentiellement destructeur comme salvateur (Clarke, sans surprise, soutien cette dernière hypothèse). Mais ensuite, le roman se termine sur une longue scène de catastrophe le long d'un ascenseur spatial presque terminé. Ce n'est pas vraiment mauvais, mais c'est forcément beaucoup moins intéressant que le reste, beaucoup moins porteur d'idées. Et l'épilogue vient ensuite nous rappeler que si The fountains of paradise est un roman fort solide, Clarke aurait pu choisir de passer un peu moins de temps sur son fantasme d'ingénieur pour explorer des thèmes plus vastes.
234 pages, 1979, Pan
Libellés :
Clarke Arthur C.,
Littérature,
Science fiction
mercredi 6 septembre 2017
Libération - Sándor Márai
Un roman écrit dans le crépuscule de la seconde guerre mondiale, quand les ruines de Budapest fumaient encore. Le personnage principal, Elizabeth, sert essentiellement à percevoir l'état étrange de la ville et les événements qui se précipitent autour d'elle. Libération me semble avant tout être un roman sur Budapest, et plus précisément un roman sur une période unique dans l'histoire de la ville : l'attente de la libération, au milieu des bombardements, des violences militaires et des combats de rue. Ce que vit Budapest dans ces pages, on peut le transposer sans difficulté à d'autres villes.
Sándor Márai cultive avec son style l'art de la répétition. Il lui arrive souvent de tourner longuement autour de la même idée, de l'examiner sous différents angles, avec insistance, quitte à employer les mêmes mots, presque les les mêmes phrases. Globalement, ça fonctionne : le portrait de Budapest est saisissant. La ville est comme figée dans l'attente, les hommes sont fatigués de faire preuve de compassion. Les sans abri cherchent désespérément un refuge dans un environnement où la venue soudaine et inattendue de la mort fait désormais partie de la normalité la plus banale. Entre deux bombardements, entre deux rafles, on va au restaurant manger tiède, on va au au théâtre voir un spectacle bancal.
Mais le moment critique arrive, les russes sont aux portes de la ville, et il devient nécessaire de se terrer de longues semaines dans les caves. Cette cohabitation forcée se passe étonnamment bien, jusqu'à ce qu'arrivent les derniers oppresseurs, qui dans les derniers moments de la guerre trouvent encore la motivation de traquer et d’exécuter les boucs émissaires, de jouir d'une autorité cruelle et sanguinaire. Et les hommes, maintenant que tout est quasiment fini, trouvent seulement maintenant l'énergie de s'indigner.
Les russes arrivent, et les libérateurs, entre hommes simples et soldats déshumanisés, font ce que les circonstances les invitent à faire : ils violent. Elizabeth, souffrant à moitié du syndrome de Stockholm, ne vit pas la libération qu'elle espérait. Je suis tenté d'écrire « comme Sándor Márai », mais je ne suis pas certain qu'il ait beaucoup espéré.
223 pages, 1945, Albin Michel
lundi 4 septembre 2017
Frontière barbare - Serge Brussolo
Un roman d'un auteur prolifique, et j'ai l’impression que cette habitude d'une production littéraire très quantitative se ressent dans son écriture. C'est à dire que tout s'enchaine à grande vitesse, les idées se succèdent les unes après les autres à un rythme effréné sans que l'auteur ne prenne le temps de s'attarder sur la structure générale. David Sarella est exovétérinaire : il s'occupe de pacifier les diverses races aliens qui aiment passer leur temps à s'entretuer. La scène d'introduction se charge de contextualiser cette étrange activité en prenant pour cadre un champ de bataille où les belligérants emploient des créatures vivantes comme armes (voir la couverture). David est ensuite expédié sur une lointaine planète où le même type de problème se répète : des civilisations entières s'y entretuent par tradition. On a rapidement l'impression que l'histoire et sa toile de fond manquent de fondations solides, mais le plaisir de lecture est bien réel, tant Brussolo jongle habillement avec tout un tas d'idées amusantes, intrigantes et souvent intelligentes.
La femme de David, suite à des expériences effectuées sur ses parents, possède des gênes d'origine alien, d'où ses pulsions morbides et son goût du sang. Et encore une fois, très bonne idée de l'auteur : à cause des phéromones exotiques qu'elle émet, cette femme est une drogue, au sens propre du terme. Du coup, quand elle meurt, David est en manque. Il se lance donc dans une aventure abracadabrante à l'autre bout de la galaxie (ou presque) pour la cloner grâce à une étrange divinité. A moins que cette prétendue déesse ne soit qu'un artéfact abandonné par une antique civilisation. Ou encore tout autre chose... Ce clonage n'est pas anodin, car David ne peut recréer sa femme que telle qu'elle subsiste dans son esprit : idéalisée, partiellement transformée et à moitié oubliée.
Je suis un peu gêné en écrivant à propos de Frontière barbare tant le roman de Brussolo me laisse une impression mitigée. D'un coté, c'est clairement de la SF intelligente, qui déborde d'idées fines comme extravagantes et qui se lit avec une aisance remarquable. Mais en même temps on ressent un clair manque de cadre, de principe directeur. L'auteur semble suivre le fil de son imagination débordante en se souvenant occasionnellement qu'il convient de lier un minimum le tout. Je me demande ce que Frontière barbare aurait pu donner avec une armature plus solide, plus carrée.
430 pages, 2013, Folio SF
samedi 2 septembre 2017
La pitié dangereuse - Stefan Zweig
Dans une ville
de province, un jeune officier se met soudain à fréquenter le château d'une
famille riche. Là, il fait connaissance d’Edith, une jeune femme
de 17 ans. Mais Edith a les jambes paralysées, et le narrateur l'ignore :
il commet une gaffe en l'invitant à danser et la plonge en larmes.
Suite à cette gaffe, il se prend de pitié pour Edith, et elle se
prendra d'amour pour lui, amour sans espoir.
Ce qui
impressionne, c'est à quel point Zweig parvient à imprégner tout
son roman du thème qui lui donne son titre. La pitié du narrateur
et ses conséquences désastreuses est la plus évidente, certes.
Mais la majorité des personnages se comportent de la même façon, à
des échelles variées. Il laissent leur pitié influer de façon
considérable leur existence, le plus souvent en encourageant les
illusions d'autrui. Et plus dure sera la chute. La fluidité et
l'intelligence de l'écriture de Zweig ne sont plus une surprise,
mais l'évocation de l'ennuyeuse vie de caserne du narrateur est
particulièrement marquante, d'autant plus que c'est cette vie qui explique sa
fascination pour le cadre raffiné, aisé et féminin qu'il trouve
chez Edith et son père. Pourtant, Zweig est plus habitué des
histoires coutres, et on a parfois l'impression que dans La pitié
dangereuse les choses s'étirent un peu trop. On se surprend à
se lasser des faiblesses du narrateur, du chantage au suicide
de cette peste d'Edith, et de voir venir de très, très loin,
l’inévitable fin dramatique. Rien cependant qui puisse empêcher
de s'embarquer avec Zweig dans cette brillante analyse du sentiment qu'est la pitié. Et les dernières pages offrent un changement
de ton rafraîchissant, quand le narrateur, après avoir connu la Grande Guerre et ses
horreurs, se retrouve porteur d'une nouvelle et triste maturité.
348 pages, 1939, Grasset
Inscription à :
Articles (Atom)