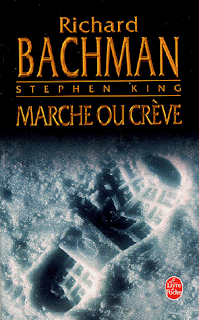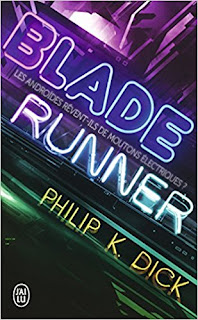Du post-apocalyptique écrit par un
auteur à la bibliographie très variée. Pendant les soixante
premières pages, j'avais quelques doutes. Le narrateur, Emmanuel,
s'attarde longuement sur son enfance à la campagne et ce qui l'a
amené à faire l’acquisition du château de Malevil. C'est une
entrée en matière un peu trop longue à mon goût. Mais dès que
les événements commencent à se précipiter, mes doutes
s'évanouissent. La scène de l'explosion atomique, dans laquelle
Emmanuel et ses potes sont par chance enfermés dans la cave de
Malevil, est excellente. La chaleur assommante, la proximité de la
mort, la difficulté d'accepter le nouvel ordre des choses... Tout
est fort bien amené et développé.
Et le roman continue sur cette lancée
en enchaînant avec brio les classiques du genre : nouvelle
organisation sociale, quête de nourriture, lutte contre les bandes
de pillards... Pourtant, le vrai sujet du roman me semble être le
leadership. Emmanuel est un vrai Machiavel. Il manipule tout le monde
avec une aisance déconcertante, retournant toutes les situations
dangereuses avec quelques belles phrases et une poignée de coups
tordus. Du coup, Malevil ressemble dans l'ensemble à un roman
sur l'art de gouverner, l'art d'être un chef. Robert Merle réussit
en bonne partie sur ce point, les manigances d'Emmanuel étant assez
croustillantes. Dommage que du coup tout semble si facile. Emmanuel
est tellement fort, tout le monde l'aime tellement, jusqu'au culte de
personnalité, que la petite communauté qui se forme à Malevil se
joue des obstacles les plus difficiles. La vie n'y est jamais
vraiment dure, les gens ne semblent jamais manquer de rien. Il y
aurait aussi beaucoup à écrire sur la place des femmes dans ce
roman. Elles sont le plus souvent représentées comme des pestes qui
se combattent pour la « domination » à la manière d'un
troupeau d'animaux, et le narrateur ne manque pas de souligner à
quel point il est plaisant de se retrouver « entre hommes ».
Soulignons aussi le caractère campagnard de Malevil. Les
personnages sont en bonne partie des paysans, plombiers ou
charpentiers qui parlent patois, sont attachés à la religion et
hostiles aux étrangers. Un cadre bien exploité par l'auteur mais
qui contribue à la domination totale d'Emmanuel, jusqu'à ce que les
autres personnages ne ressemblent plus qu'à du bétail soumis à un
divin berger.
636 pages, 1972, folio